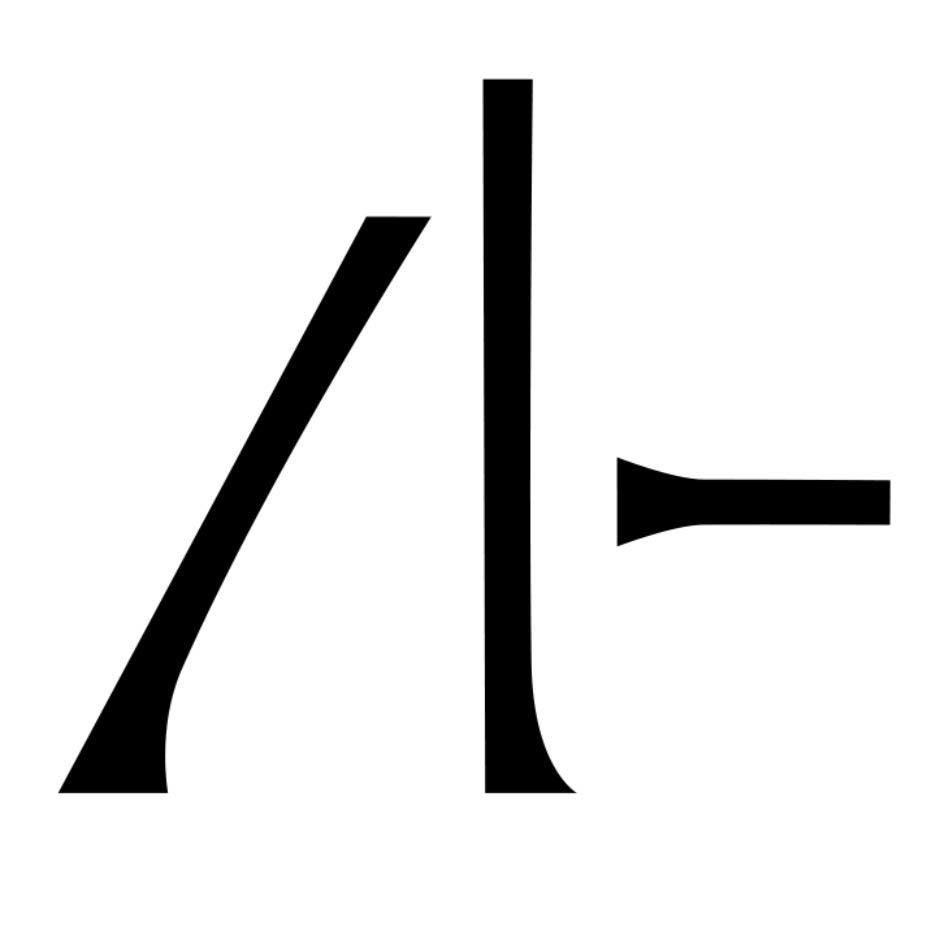Lorsque vous débutez votre carrière artistique au début des années 80, quelle est la tendance artistique au Sri Lanka ?
Quand j’ai commencé ma carrière artistique, nous étions dans un style modernisme, guidé par les expressionnistes abstraits. Je n’ai jamais aimé l’art abstrait car je pense que l’art doit raconter une histoire. À partir d’un certain moment, il y avait tellement de souffrance au Sri Lanka que nous devions trouver une autre forme d’art pour nous exprimer. C’est arrivé aussi en Inde et en Chine à peu près à la même époque. Dans les années 90, les artistes contemporains sri-lankais ont commencé à narrer leurs histoires personnelles. Nous ne parlions pas seulement de la guerre, mais aussi de notre conception de la sexualité, du statut de la femme dans nos sociétés, et plus généralement des conditions sociétales qui avaient permis à la guerre d’arriver. L’art des années 90 a donné du pouvoir à une génération d’artistes qui refusaient d’être contrôlés pour leur sexualité, leur genre ou leur origine.
Je pense que nous sommes arrivés au paroxysme de cette tendance. Si vous prenez par exemple un artiste comme Dumith Kulasekara, son œuvre s’articule tellement autour de sa représentation idiosyncratique du symbolisme qu’il est impossible de la comprendre seul.
Comment décririez-vous l’évolution de la scène artistique depuis la fin de la guerre ?
Durant la guerre (à partir de 1983, le pays subit une guerre civile, opposant la majorité cinghalaise bouddhiste et les Tigres de libération de l'Îlam tamoul, et ce jusqu’en 2009), tous les artistes travaillaient main dans la main, au nord comme au sud. Notre art était en dehors des institutions et de toute forme de pensée dominante. En temps qu’artistes bouddhistes, nous essayions de développer la scène artistique à Jaffna et dans la province du Nord, qui endurait des conditions terribles. J’ai été directeur du département d'archéologie de la University of Kelaniya pendant cette période, et nous sommes allés, avec le corps enseignant, à Jaffna, pour former des étudiants.
Depuis la fin de la guerre, le pays est divisé politiquement entre deux mouvances identitaires qui tentent de définir l’essence de notre nation. Le nationalisme du sud d’abord, qui s’articule autour de l’idée d’un âge d’or du Sri Lanka ; le nationalisme tamoul ensuite, qui se pose en réaction aux attaques faites par les nationalistes du sud, ce qui est par ailleurs fondamentalement incorrect. Le nationalisme, en temps que doctrine politique, existe par opposition à une autre idéologie. Il est toujours une réponse, et ces deux groupes identitaires se renforcent l’un l’autre. Ces enjeux politiques ont ressurgi au sein de la communauté artistique, les artistes du nord veulent séparer leur histoire de la nôtre, ils développent par exemple des programmes autour de Jaffna uniquement. Je me sens frustré par cette situation, et je pense qu’elle fait beaucoup de tort à notre culture.
Côté liberté d’expression, il n’existe pas de censure à proprement parler, mais nous pouvons avoir des contentieux avec le gouvernement si nous devenons trop virulents contre le bouddhisme. Pourtant nous sommes majoritairement bouddhistes à Colombo, et je pense que c’est un droit fondamental de pouvoir critiquer sa propre religion, pas simplement pour être contestataire mais surtout pour la comprendre.
Il semble que le nationalisme soit très présent au Sri Lanka, même au sein de la sphère artistique et culturelle…
Il s’agit de différencier le nationalisme comme exaltation d’un sentiment national, du nationalisme comme doctrine politique.
Depuis que l’humanité est devenue sédentaire, l’homme se définit en fonction d’un territoire particulier. Nous passons du temps dans un espace et nous construisons notre conscience en lien avec ce dernier. En ce sens, je pense que le nationalisme sensible est inhérent à la pensée.
A contrario, le nationalisme politique est une erreur sémantique et philosophique. Ici, les nationalistes du sud revendiquent des territoires du nord du pays aux tamouls et aux musulmans et utilisent pour ce faire l’archéologie afin de prouver que ces territoires étaient bouddhistes au 15ème siècle. En temps que bouddhiste du sud, je ne peux pas vous dire que j’appartiens à Jaffna (capitale de la province du Nord) alors que je n'ai que visité cette ville. Il y aussi au sein de ces nationalismes politiques une grande confusion entre notre héritage traditionnel et notre héritage colonial. Nous ne réalisons même plus que certaines choses de notre vie sont des traces de la colonisation, et nous ne pouvons pas revenir en arrière comme beaucoup de nationalistes l’exigent car ces héritages font partie de notre identité actuelle.
Quel est l’état de la formation artistique à Colombo ?
Les études d’art proposées à Colombo restent très formelles. Pour faire de l’art figuratif, vous avez besoin d’acquérir un certain niveau de compétences, tandis que si vous faites de l’art contemporain, ce sont vos idées qui seront valorisées. Si vous donnez plus d’importance à la technique qu’au concept, vous pouvez plus facilement contrôler l’art qui est produit. J’ai toujours considéré les formations académiques formelles comme largement insuffisantes. Pour combler les lacunes de cet enseignement, nous avons créé en 2000, avec plusieurs artistes sri-lankais, le collectif Theertha (initiative à but non lucratif, sur laquelle nous reviendrons dans nos prochains articles). Depuis, nous proposons aux étudiants une formation artistique pluridisciplinaire dans le but de créer chez eux un esprit critique, complètement absent des autres formations proposées à Colombo.
Quelles type d'initiatives essayez-vous de promouvoir au sein de Theertha ?
À travers le collectif Theerta, nous essayons de valoriser l’art communautaire, c’est-à-dire une forme créative qui utilise l’art comme processus de réflexion et d’introspection, adressée vers une communauté. J’ai par exemple commencé un projet intitulé The grounded memories, dans lequel j’essaye de comprendre comment les notions d’héritage et d’histoire résonnent au sein de la communauté musulmane qui vit à l’est du Sri Lanka. Il faut repenser l’héritage et l’histoire comme des expressions de la temporalité du territoire. Analyser les espaces que les membres de cette communauté apprécient ou non me permettra de leur enseigner ces deux concepts afin qu’ils se les approprient pour leur vie personnel. Concrètement, je vais récolter leurs témoignages pour construire avec eux une carte imaginaire, fonction de leurs expériences, que je projetterai sur la carte du Sri Lanka.
C’est un projet à l’encontre des politiques nationalistes, et j’espère qu’il donnera à cette communauté un support pour que ses membres puissent défendre leur culture. Il s’agit de revaloriser une vérité sociologique, en opposition à l’idéologie nationaliste dans laquelle la réalité archéologique est prépondérante.
Votre dernier projet est très engagé politiquement. Pensez-vous que l’art peut encore avoir une influence sur nos sociétés contemporaines ?
Je pense que le milieu des arts visuels, en particulier le système des grandes institutions et galeries internationales, est le milieu le plus corrompu du monde. Les curateurs (forme moderne des commissaires d’exposition) peuvent être très bon, mais ils font aussi partie du problème. Beaucoup de curateurs viennent par exemple à Jaffna en cherchant une certaine identité artistique, comme si la ville ne faisait pas partie de Sri Lanka. Dans un même temps, ils essayent de prendre possession du futur du monde de l’art. Regardez simplement le nombre de programmes, dirigés par des curateurs, qui utilisent le mot « futur ». Le Future Generation Art Prize, la Children’s Biennale à Venise… L’idée même de montrer le futur de quelque chose, ici de l’art, est philosophiquement absconse. Vous ne pouvez pas montrer autre chose que le présent, ou la projection que vous imaginez du futur, qui sera toujours fonction du présent et jamais futur. Montrer le futur de l’art est une façon de monopoliser le futur et je trouve cette démarche très dangereuse.
La question est finalement de savoir si les artistes contemporains révèlent une condition particulière, ou tirent profit de cette condition. Je pense que l’art qui est le mieux considéré aujourd’hui exploite des faits mais ne révèle rien. L’aspect anthropologique de nos sociétés non occidentales est quelque chose qui se vend très bien, et qui intéresse les grandes institutions et le marché de l’art en général. Aujourd’hui, les grandes galeries raffolent des œuvres qui font référence à un événement dans le monde en le présentant de façon soignée et très élitiste. C’est une forme de gentrification des émotions humaines. C’est comme donner 2$ pour une cause lorsque vous achetez un café chez Starbucks et considérer que vous avez fait votre part de bonnes actions. Ces œuvres créent une distance entre les réalités qu’elles montrent et le public. Le rôle d’un artiste est de révéler des faits, et non pas de les mystifier, sinon on tombe dans ce que j’appelle de l’esthétisme corporatiste. Je déteste ce monde de l’art qui utilise la souffrance humaine pour la transforme en un objet élégant.
Comment pensez-vous l’art contemporain aujourd’hui au Sri Lanka ?
Aujourd’hui, notre marché est plus organisé donc plus interventionniste. L’art devient parfois manipulé par le marché et les curateurs. À Colombo, le marché de l’art est assez établit et il est difficile pour un artiste d’entamer une recherche artistique, beaucoup d’œuvres sont vendus avant d’être exposées. J’ai peur pour les artistes du nord et de l’ouest du pays car ils produisent beaucoup de travaux à direction des galeries et des curateurs, et sont trop souvent catégorisés.
De façon générale, l’art contemporain au Sri Lanka est toujours articulé autour de l’idée du soi dans une violence organisée. La guerre est présente, nous luttons encore contre ce traumatisme et il est important que les artistes témoignent de cette période pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Si vous oubliez la guerre, vous la laissez revenir.

Dans l'atelier de Jagath Weerasinghe

Dans l'atelier de Jagath Weerasinghe