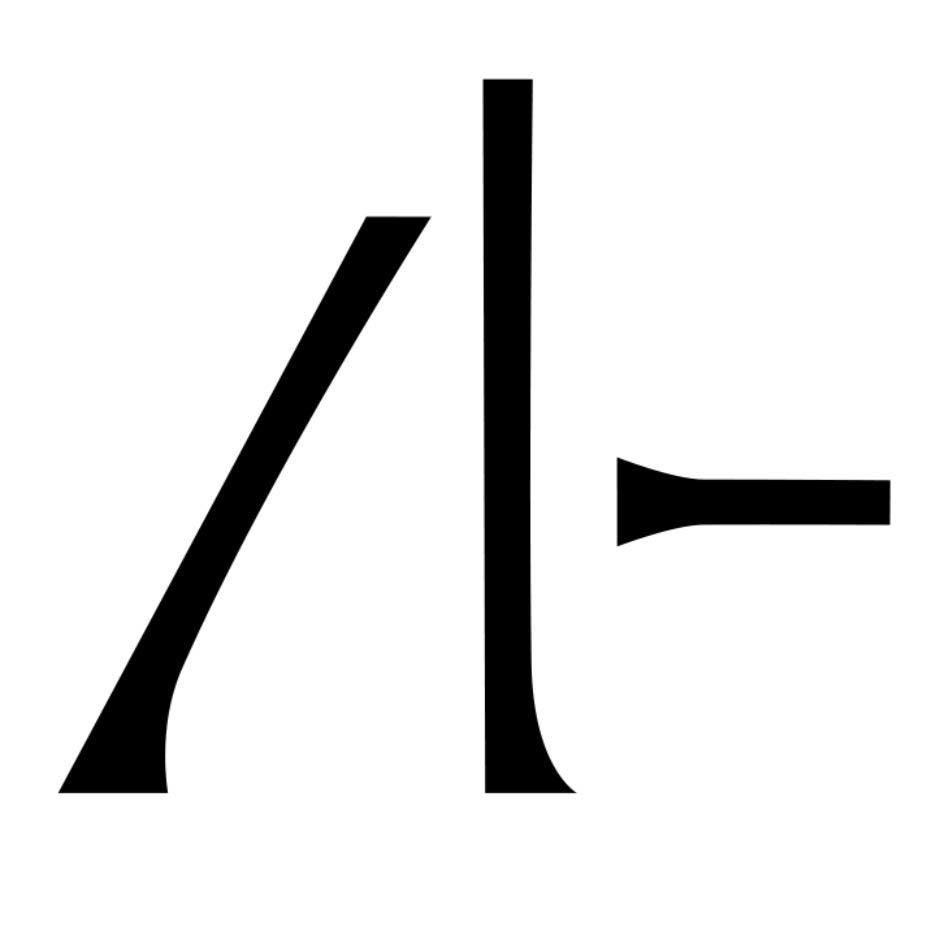Comment avez-vous fait vos premiers pas dans le milieu du cinéma ?
Jeune, je faisais de la photographie de guerre. Les journalistes français venaient souvent au Liban. J’étais francophone et j’habitais sur la ligne de démarcation donc je les aidais à traduire de l’arabe au français, j’étais leur guide. Nous connaissions bien les lignes de démarcation et les miliciens, nous étions un peu le go between. J’aidais les journalistes et ils me donnaient des films, en me disant que s’il y avait un bombardement, je devais aller le filmer et le photographier. C’est ce que j’ai fait, au point d’en être dégouté. C’est un sale métier reporteur de guerre, il faut aller voir la misère de près et plus les mouches sont devant l’objectif plus l’image est bonne… J’ai été très vite dégouté parce que j’étais jeune et sensible. J’ai fini par arrêter mais j’étais bon photographe.
Je savais depuis mes 14 ans que je voulais être réalisateur. Je suis parti tout jeune, à 18 ans, en France en croyant que c’était le Nevada, que j’allais y faire fortune et que la France allait m’accueillir. Je suis resté 3 mois à chercher du boulot naïvement et j’ai fini par trouver un stage à Londres dans une boite de production.
J’ai travaillé pendant un an à Londres, et je suis revenu au Liban en 1985 à la création de la LBC (Lebanese Broadcasting Corporation – première chaine de télévision privée, ancienne chaine des forces libanaise). Ils m’ont tout de suite pris en temps que réalisateur et j’ai réalisé mon premier documentaire diffusé à 21 ans. J’ai fait des reportages sur le Liban pour la France pour 7/7, TF1, des magasines d’antenne 2…
En 2005 vous sortez votre premier long-métrage Bosta, qui obtient un franc succès au Liban. Comment analysez-vous cette réussite ?
En 1996, j’ai fait le constat que le cinéma que nous faisions était un cinéma qui faisait plaisir à l’occident, c’est toujours ce même cinéma par ailleurs...
Pour financer le cinéma libanais, il existait des fonds Sud, c’est-à-dire des fonds d’aide au cinéma du monde, et quelques autres fonds à droite ou à gauche. Les films libanais produits par ces fonds étaient des films de niches, traitant de sujets pour la plupart dénonciateurs, de la femme battue en Orient à la pauvreté, la guerre, la misère... Le cinéma que nous faisions n’était pas un cinéma qui plaisait au public libanais, nous faisions 1 000 à 2 000 entrées dans les salles au Liban, ce qui est très peu. C’était du cinéma sur le territoire libanais mais pour une exportation occidentale.
J’ai voulu faire un film local qui serait appréciable par les libanais. Bosta, c’est une histoire de vie. L’un des slogans que nous avons utilisés au moment de l’affiche était je danse sur ma plaie. Bosta racontait autre chose que la guerre, il racontait un désir de vivre.
J’ai présenté le film au fond Sud, ils m’ont répondu en France qu’ils aidaient le cinéma porté sur les sujets sensibles du sud, pas le cinéma grand publique. Le cinéma du sud est selon moi difficile par essence puisqu’il n’y a rien pour nous aider. Le CNC m’a expliqué que « c’était un film loin de la réalité libanaise ». J’ai été tellement dégouté qu’on me dise que ce n'était pas ma réalité à moi que je suis parti au Liban, j’ai cherché de l’argent de plusieurs investisseurs, j’ai fait mon film et je l’ai distribué.
Le film a fait 140 000 entrées, il a été le premier film à renouer avec la tradition des libanais à aller au cinéma, ça a créé un boost au Liban.

Extrait du film Bosta

Extrait du film Bosta

Extrait du film Bosta
Sous les bombes, notre deuxième long métrage, est un film tourné durant la guerre de 2006. Vous racontez que ce thème s'est imposé à vous ?
En 2006, la guerre éclate à nouveau. Tout ce que j’avais essayé de transcender par de l’art s’est effondré. Ça m’a ramené tous mes souvenirs du passé. J’ai décidé d'amener deux acteurs très connus, Georges Khabbaz et Nada Abou Farhat, et je suis allé avec eux sur le terrain pour improviser pendant 10 jours des séquences sur une histoire que je n’avais pas encore écrite : une femme vient de Dubaï pour récupérer son fils qu’elle avait laissé avec sa sœur dans le sud, elle décidé de prendre un taxi pour l’amener et l’aider dans cette recherche. Le film s’est terminé en 11 mois, c’était hyper rapide, et nous avons eu 23 prix pour ce film.
Affiche de Sous les bombes
A travers votre film Héritages, vous vous interrogez sur l'histoire du Liban et ce qui fait sa mémoire. Où ces questionnements vous ont-ils amené aujourd'hui ?
Nous n’avons pas d’histoire au Liban, le livre d’histoire s’arrête en 1943 (date de l’indépendance) ou en 1975 (début de la guerre civile). Quand les gens n’ont pas d’histoire, ils veulent la connaître, donc ils la répètent. Dans la psycho généalogie, quand on dit l’histoire se répète c’est que les gens ne connaissent pas leur passé et qu'ils ont le désir de le répéter. C’est comme si en le répétant tu essayais d’apprendre ce que ton père a vécu. J’ai fait beaucoup de recherche sur l’histoire du Liban pour faire ce film qui est aujourd’hui enseigné dans beaucoup d’écoles au Liban.
J’essaye de montrer dans mes documentaires et dans mes films ce qui nous fédère, ce qui fait que nous sommes un. Je pense que c’est une responsabilité du cinéma libanais.
Dans les années 1950-1960, il y a eu un désir d’unir, mais le contexte ne le permettait pas facilement avec la présence des palestiniens, Israël d’un côté et la Syrie de l’autre qui ne digérait pas la perte d’une partie de son territoire. La guerre a fini par éclater en 1975. Depuis la guerre il y a un effritement, lent, très lent. Mais le Liban est un pays qui vient de naitre, nous sommes encore aux prémisses d’une identité libanaise.

Extrait du film Héritages

Extrait du film Héritages

Extrait du film Héritages
Comment définiriez-vous votre cinéma ?
J’aime bien ce mot qu’un producteur m’avait dit, je fais parti du cinéma du milieu, ni tout à fait grand publique ou popcorn film, ni tout à fait d’art et d’essai. Je fais un cinéma du milieu donc je considère que mon discours doit être accessible.
Où va le cinéma libanais aujourd’hui ?
La scène artistique est en ébullition, le Liban est une terre très fertile. Nous sommes tous en train de chercher qui nous sommes, que ce soit le cinéma de Ghassan Salhab, de Danielle Arbid, de Ziad Doueiri, une partie du cinéma de Nadine Labaki… Nous ne sommes pas encore passés au stade de raconter purement une histoire.
Le challenge c’est aussi de trouver un sujet fédérateur au Liban et universel, pour que l’histoire fonctionne à l’étranger. L’art aujourd’hui va vers une quête d’identité, le cinéma est le miroir d’une temporalité. A chaque fois que nous faisons un film c’est le miroir d’un temps, je crois que c’est ça notre vrai devoir.
Quel rôle a le cinéma et plus généralement l’art au Liban ?
Les artistes sont les seuls à questionner le passé, ils ont eu le courage de faire ce travail de mémoire sur la guerre civile et les moments difficiles de notre histoire que les historiens n’ont pas fait. Le ministère de la culture a créé une fois par an la nuit des musées comme en France, la fréquentation est montée, il y a de plus en plus de musées, il y a un vrai désir de la part de la population. Maintenant, est-ce que ce que vous faites sur la scène culturelle ici à Beyrouth aura une répercussion sur tout le reste du pays et changera les choses, ça c’est encore une autre question.
J’ai rencontré un père qui, après avoir vu Héritages, m’a dit « ça fait 30 ans que je veux raconter mon histoire à mes enfants, ce que j’ai vécu de la guerre, et je n’ose pas ouvrir une conversation. Et voilà que ton film est une occasion magique pour pouvoir ouvrir la conversation ». Quelque part ça a dû changer des choses chez certains individus dans une certaine manière. De là à créer un changement de masse je ne suis pas sur. Je n’aime pas avoir des velléités au sens large.